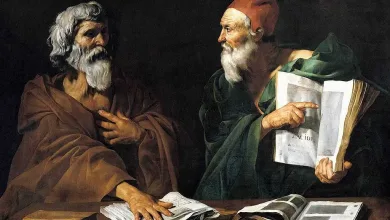Une annonce de quelques jours a attiré l’attention des médias et des passionnés : l’entreprise Colossal Biosciences aurait « ramené à la vie » (ou déséteint, comme certains aiment l’écrire) un loup ancien de la famille Canis dirus, prédateur emblématique du Pléistocène. La nouvelle, amplifiée par la similitude avec les loups géants de « Game of Thrones », mérite cependant une analyse plus attentive car ce n’est pas exactement ainsi que les choses se sont passées.
Ont-ils ramené à la vie un loup préhistorique… Ou juste un loup en costume de cosplay ?
Le loup en question n’est pas une créature mythologique, mais un véritable carnivore ayant vécu jusqu’à environ 10 000 ans en Amérique. Avec une longueur atteignant deux mètres et des mâchoires très puissantes, ce prédateur chassait de grands mammifères comme les bisons et les mastodontes. Son extinction a probablement coïncidé avec la disparition des proies géantes qui constituaient sa subsistance.
Mais qu’a réellement créé Colossal ? Les spécimens présentés en octobre et janvier ne sont pas de véritables « dire wolves », mais plutôt des loups gris génétiquement modifiés.
Les chercheurs ont analysé l’ADN ancien extrait de fossiles et identifié des variantes génétiques caractéristiques du Canis dirus, pour ensuite en introduire 15 dans le génome du loup gris, modifiant 14 gènes à 20 positions différentes.
Le résultat a été la naissance de deux animaux avec un aspect rappelant l’ancien prédateur : pelage plus épais et sombre, crâne massif, oreilles plus courtes. Un « relooking » génétique, pas une véritable résurrection. Ironiquement, leurs noms sont Romulus et Rémus.
Cette approche soulève des questions fondamentales : peut-on définir « déséteint » un organisme simplement parce qu’il en reproduit certaines caractéristiques esthétiques ? Les études de 2021 ont démontré que ces loups spécifiques appartenaient à une ligne évolutive séparée de celle des loups gris depuis environ 5,7 millions d’années, une distance comparable à celle entre humains et chimpanzés.
La paléogénéticienne Beth Shapiro, impliquée dans le projet, admet que l’objectif n’était pas de créer un clone parfait, mais une « version fonctionnelle » de l’animal éteint. De nombreux scientifiques, cependant, contestent cette vision.
Comme l’observe la paléoécologue Jacquelyn Gill, ces animaux ne peuvent rien nous dire sur le véritable comportement ou l’écologie du Canis dirus car il y a des aspects irrécupérables qui vont bien au-delà de la génétique.
Les spécimens vivent actuellement dans une réserve privée aux États-Unis. L’aspect le plus prometteur de cette expérimentation ne concerne pas tant la « résurrection » d’espèces éteintes, mais l’application des techniques développées pour sauver des espèces en danger comme le loup rouge, dont la faible diversité génétique menace la survie.