Il y a des personnes qui ne parviennent à rien oublier, même pas les détails les plus insignifiants de leurs journées. Cela semblerait être un superpouvoir, mais pour ceux qui vivent avec cette « capacité » (qui est en réalité une condition appelée Syndrome Hyperthymésique), c’est souvent une condamnation. Les chercheurs essaient de comprendre ce qui rend possible l’oubli et pourquoi, pour la plupart d’entre nous, il est fondamental de le faire.
Pourquoi nous oublions : ce que révèle la mémoire absolue sur notre cerveau
« J’ai des problèmes de mémoire« , écrivait une femme californienne dans un e-mail au neuroscientifique James McGaugh. Mais la suite laissa le chercheur stupéfait : « Je revis chaque jour de ma vie dans ma tête et cela me rend folle !!!« . C’était le début d’une découverte scientifique extraordinaire.
Jill Price, 34 ans, n’oublie pas. Jamais. Chaque date mentionnée réveille dans son esprit un film net : événements, personnes, météo, même ce qu’elle portait ce jour-là. Un phénomène si inhabituel qu’il mérite un nom spécifique : syndrome hyperthymésique ou Highly Superior Autobiographical Memory (HSAM).
Mais que signifie vivre sans la capacité d’oublier ? L’esprit de Jill conserve intacts même les expériences douloureuses, les traumatismes, les humiliations, les pertes. Chaque souvenir reste vif, impossible à atténuer avec le temps. Le résultat est anxiété chronique, dépression, difficulté à « tourner la page ». Un don qui se transforme en tourment.
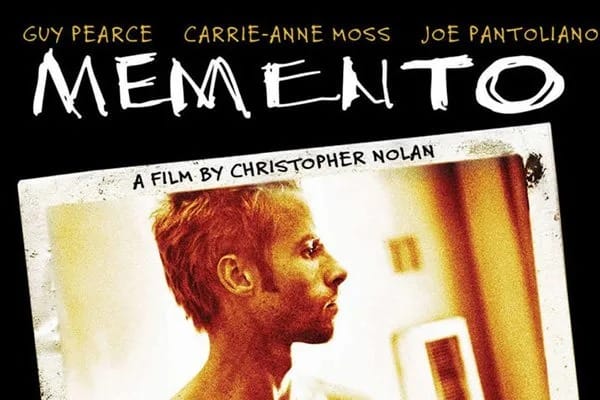
Oublier, expliquent les scientifiques, n’est pas un défaut mais une nécessité biologique. Ce processus est comparable à un « nettoyage de printemps » neuronal : le cerveau doit éliminer le superflu pour fonctionner correctement. Ce n’est pas une usure passive, mais un mécanisme actif et sain.
En 2014, une équipe de chercheurs a identifié le « gène musashi » comme possible régulateur de l’oubli chez les vers. Curieusement, en analysant ce gène chez les personnes avec HSAM, ils n’ont trouvé aucune anomalie.
D’où le défi : McGaugh a recueilli des échantillons génétiques de 21 personnes avec HSAM et de leurs familles. Aujourd’hui, ces matériaux sont de l’or pour la recherche. À Bâle, les scientifiques passent ces ADN au peigne fin avec une précision maniaque, cherchant des séquences uniques absentes chez 100 000 autres personnes.
C’était comme chercher une aiguille dans une botte de foin : cela pouvait être une combinaison rare de plusieurs gènes ou des mutations dans des régions non codantes. L’enjeu ? Comprendre non seulement l’HSAM, mais aussi des troubles comme l’Alzheimer ou le PTSD, où l’équilibre entre souvenir et oubli est compromis.
De cela émergent des questions existentielles d’une importance énorme. Que se passerait-il si nous pouvions moduler notre capacité à oublier ? Peut-être que la question la plus intrigante concerne la frontière entre mémoire normale et pathologique : quand est-ce que se souvenir devient trop, et quand oublier devient trop peu ?







